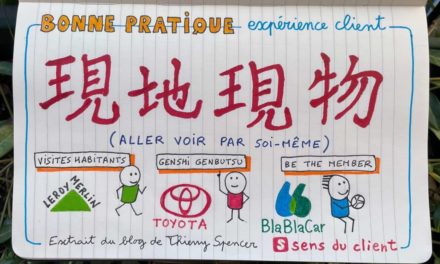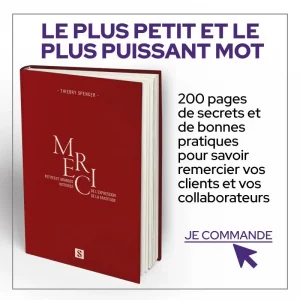Bienvenue dans le deuxième épisode de ma nouvelle série « Florilège de la culture client » composée de faits et chiffres, de citations, de blagues et d’histoires qui touchent de près ou de loin la relation client, le monde du service, de l’expérience client et de la culture client.
Pour pour chaque billet, voici sept brèves de culture client : histoires, humour, bon à savoir, petites et grandes histoires, mots inspirants et bonnes pratiques sur le thème de l’attente.
Sept choses à savoir sur l’attente, les files et queues pour les clients.
Humour
C’est en allant aux urgences qu’on comprend pourquoi on nous appelle les patients
Petites et grandes histoires
Connaissez-vous l’Erlang ?
Agner Krarup Erlang, mathématicien danois, est le pionnier de l’étude du trafic des télécommunications au début des années 1900. Il est l’un des premiers créateurs de la théorie des files d’attente et le père de la mesure Erlang. Alors qu’il travaillant pour le central téléphonique de Copenhague, il a cherché à résoudre le problème du nombre de circuits nécessaires pour fournir un service téléphonique acceptable à un village local. Il voulait également savoir combien d’opérateurs téléphoniques étaient nécessaires pour traiter un volume donné d’appels. À l’époque, la plupart des centraux téléphoniques utilisaient des opérateurs humains et des standards pour connecter les appels téléphoniques à l’aide de prises de type jack. En 1909, il publie The Theory of Probabilities and Telephone Conversations dans lequel il développe le concept de la théorie des files d’attente téléphoniques.
Il donnera son nom à une unité : l’erlang, utilisée dans le domaine de la téléphonie comme une mesure du taux d’occupation d’un équipement de communication sur une période donnée. Un erlang correspond à l’occupation maximale d’un équipement permettant l’acheminement d’une seule communication téléphonique (ce qui, dans le cas de l’étude d’une période d’une heure, correspond par exemple à une communication d’une heure, ou à dix communications de six minutes).
Principes et conseils
Le syndrome de la file d’à côté
Ce sentiment universel que la file voisine avance plus vite que la nôtre a été étudié par des chercheurs en psychologie et en mathématiques. Donald Redelmeier et Robert Tibshirani (Université de Toronto) l’ont décrit dès 1999 dans une étude sur la perception du temps d’attente en situation de conduite et dans les files, en montrant que nous avons tendance à surestimer la vitesse des autres et à retenir plus intensément les expériences négatives que les positives.
Ce phénomène repose sur plusieurs biais cognitifs (mécanismes de la pensée qui entraînent une déviation du jugement) :
- Biais d’attention sélective : notre cerveau se focalise sur les moments où l’autre file progresse, ignorant ceux où la nôtre avance plus vite. « Ca fait 5 minutes que j’observe les clients et la caissière et j’ai l’impression qu’on avance plus vite à côté ».
- Biais de négativité : les expériences frustrantes marquent plus notre mémoire et influencent notre jugement. « A chaque fois que je fais la queue, je choisis la mauvaise file et j’attends des heures ».
- Illusion de contrôle : changer de file nous donne l’impression d’agir sur la situation, même si les statistiques montrent souvent que ce changement n’améliore pas — voire rallonge — le temps total d’attente. « Pff, j’ai bien fait de changer, il était temps ».
Des travaux de recherche en file d’attente (notamment ceux de Richard Larson, surnommé « Docteur Queue » au MIT) ont également montré que l’attente perçue est souvent plus importante que l’attente réelle, et que notre frustration est exacerbée lorsque nous comparons notre progression à celle des autres. Le syndrome de la file d’à côté n’est pas qu’une simple impression : c’est un mélange de mathématiques, de psychologie et de perception humaine… qui rappelle que, dans l’expérience client, gérer l’attente, c’est surtout gérer la perception de l’attente.
Bon à savoir
Les différents types de files d’attente
- Les files séparées. Dans les points de vente où il y a plusieurs guichets, chaque guichet possède sa propre file. C’est le cas, par exemple, des caisses dans les supermarchés ou des guichets de billetterie. Ce système est simple à mettre en place et visuellement clair pour les clients. Cependant, il comporte un inconvénient majeur : il peut rapidement générer de la frustration. En effet, certaines files avancent plus vite que d’autres en fonction de la rapidité du caissier, de la complexité des achats ou du comportement des clients. L’effet est encore plus marqué lorsqu’un nouveau guichet ouvre : les derniers arrivés peuvent devenir les premiers servis, ce qui peut créer un sentiment d’injustice. Dans le jargon de l’expérience client, on parle ici du syndrome de la file d’à côté (celle qui avance toujours plus vite… cf note précédente sur ce syndrome) jusqu’à ce que l’on change de file.
- La file distribuée ou mutualisée. Ici, une seule file unique alimente plusieurs guichets. On la trouve notamment dans les banques, aux enregistrements d’aéroport ou dans certaines chaînes de restauration rapide. Son grand avantage est de répartir équitablement le flux entre les agents, réduisant ainsi le temps d’attente moyen et minimisant le sentiment d’injustice. En cas de blocage à un guichet (incident technique, client ayant une demande complexe), le reste de la file continue d’avancer vers les autres guichets disponibles. Cela rend le service plus fluide et équilibré, tout en limitant les « goulots d’étranglement ». Ce système est très apprécié des clients, même si certains peuvent être déroutés par sa configuration lorsqu’ils y sont peu habitués.
- La file immersive ou serpentine. Conçue pour accueillir un grand volume de visiteurs dans un espace limité, elle serpente en zigzag afin de donner l’impression que la file avance régulièrement. On la trouve principalement dans les parcs d’attractions, certains musées très fréquentés ou dans les aéroports au contrôle de sécurité. Dans les parcs comme Disneyland, Universal studios ou Astérix, elle fait partie intégrante de l’expérience : décors, musique, effets spéciaux, écrans interactifs ou rencontres avec des personnages transforment l’attente en prélude à l’attraction. Cette « immersion narrative » permet de réduire la perception négative du temps d’attente en le rendant plus actif et engageant. Bien pensée, elle fluidifie le passage tout en divertissant. Mal conçue, elle peut au contraire accentuer l’inconfort si la chaleur, le bruit ou la promiscuité dominent. Une étude universitaire (thèse de Jonathan Ledbetter, 2016) montre que le niveau d’immersion — via des distractions cognitivement engageantes dans la file — module la perception de la durée d’attente. Plus l’immersion est forte, plus le temps paraît court
- La file virtuelle. Dans ce système, il n’est pas nécessaire de se tenir debout dans un rang physique. Le client prend un ticket numéroté qui conserve l’ordre d’arrivée et lui permet d’attendre assis, voire de s’occuper autrement. On retrouve généralement ce dispositif dans les administrations, hôpitaux, services après-vente ou comptoirs de retrait de produits. Côté expérience client, la file virtuelle offre plus de confort, mais elle n’élimine pas totalement l’attente : elle la rend simplement moins visible et moins pénible. L’attente est perçue comme plus courte lorsqu’on a la vue sur les numéros qui sont devant le nôtre. IKEA, comme certaines chaines de magasin, ajoutent une vidéo (souvent la même qui tourne en boucle) qui montre l’intérieur de l’entrepôt où les collaborateurs s’affairent à préparer votre colis.
- La file virtuelle mobile. Avec les outils numériques, il est désormais possible d’« attendre » à distance. Le client s’inscrit dans la file via une application ou un site internet. Il reçoit ensuite une notification — souvent par SMS ou sur whatsapp — lorsque son tour approche. Ce système est de plus en plus utilisé dans les restaurants, les commerces de centre-ville ou même certains services publics. Il améliore considérablement l’expérience client car il libère le temps d’attente pour d’autres activités. Toutefois, il nécessite une bonne organisation et une communication claire pour éviter que le client ne rate son tour.
- La file prioritaire. Certaines files sont réservées à des publics spécifiques : personnes à mobilité réduite, femmes enceintes, personnes âgées, ou clients disposant d’un statut premium (programme de fidélité, carte prioritaire, billet en classe affaires, etc.). On les retrouve dans les gares, aéroports, parcs d’attractions ou certains magasins. Si elles sont perçues comme un confort appréciable par ceux qui en bénéficient, elles peuvent aussi susciter un sentiment d’injustice chez les autres clients, surtout si leur gestion n’est pas expliquée ou si elles ralentissent la file générale. Leur efficacité dépend donc d’un bon équilibre entre priorité et fluidité globale du service.
Quelle que soit sa forme, la file d’attente n’est pas qu’un simple outil d’organisation : c’est une expérience en soi, qui influence directement la satisfaction et la perception du service. Bien pensée, elle peut transformer un moment perçu comme perdu en opportunité d’informer, de divertir ou même de valoriser le client. Mal conçue, elle se transforme au contraire un irritant majeur. La clé est donc d’adapter le type de file au contexte, au volume de clients et à l’expérience que l’on souhaite offrir — car, dans bien des cas, ce n’est pas seulement le temps d’attente qui compte, mais la façon dont il est vécu.
Petites et grandes histoires
Les pros de la file
Same Ole Line Dudes (SOLD) est un service new-yorkais spécialisé uniquement dans l’attente en file d’attente. Les « Line Dudes » se placent à l’avance dans la queue (concerts, sorties de produits Apple, restos à forte demande, etc.) et vous rejoignez la file quand c’est bientôt votre tour. Le service a été fondé en 2012 par Robert Samuel, après avoir gagné plus de 300 $ en une journée en attendant dans une file pour l’iPhone 5 et en revendant sa place. Parmi les pros de la file, on compte aussi TaskRabbit, une plateforme américaine de « gig economy » où l’on peut embaucher des particuliers pour effectuer diverses tâches (montage de meubles, ménage, courses, etc.). Parmi ces tâches, on trouve parfois… faire la queue à votre place, jusqu’à ce que vous arriviez.
Bon à savoir
La surestimation intentionnelle des temps d’attente de Disney
Disney applique une stratégie subtile : ils affichent des temps d’attente légèrement plus hauts que la réalité, dans une logique « sous-promettre, sur-délivrer » (underpromise, overdeliver). L’effet ? Les visiteurs sont agréablement surpris et perçoivent le temps comme plus court que prévu
Bon à savoir
L’origine des miroirs dans les ascenseurs
Les miroirs installés dans les ascenseurs ne sont pas là uniquement pour permettre aux passagers de vérifier leur apparence. Leur présence a une origine très pratique liée à la perception humaine du temps et de l’attente. Dans les années 1950-1960, les designers et architectes d’intérieur ont commencé à intégrer des miroirs dans les cabines d’ascenseur pour aider à réduire l’ennui, l’anxiété et l’inconfort des usagers. En effet, lorsque l’on est dans un espace confiné comme un ascenseur, on perçoit souvent le temps comme plus long, ce qui peut générer stress et impatience. Dans son livre « Mirror meditation », le docteur Tara Well écrit : « Il existe de nombreuses suggestions pour utiliser le miroir pour gérer l’anxiété, accroître l’acceptation de soi, gagner en confiance et simplement profiter de regarder votre image au lieu de la critiquer. Devenir ami avec votre reflet présente de multiples avantages au-delà des déplacements en ascenseur. Vous pouvez apprendre à utiliser le miroir à votre avantage ! »
1173ème billet signé Thierry Spencer, conférencier, créateur du blog Sens du client, consultant et co-fondateur de KPAM Next, auteur du récent livre « Merci, petites et grandes histoires de l’expression de la gratitude » .
Mon livre blanc des tendances client 2025 est en téléchargement gratuit en suivant ce lien.