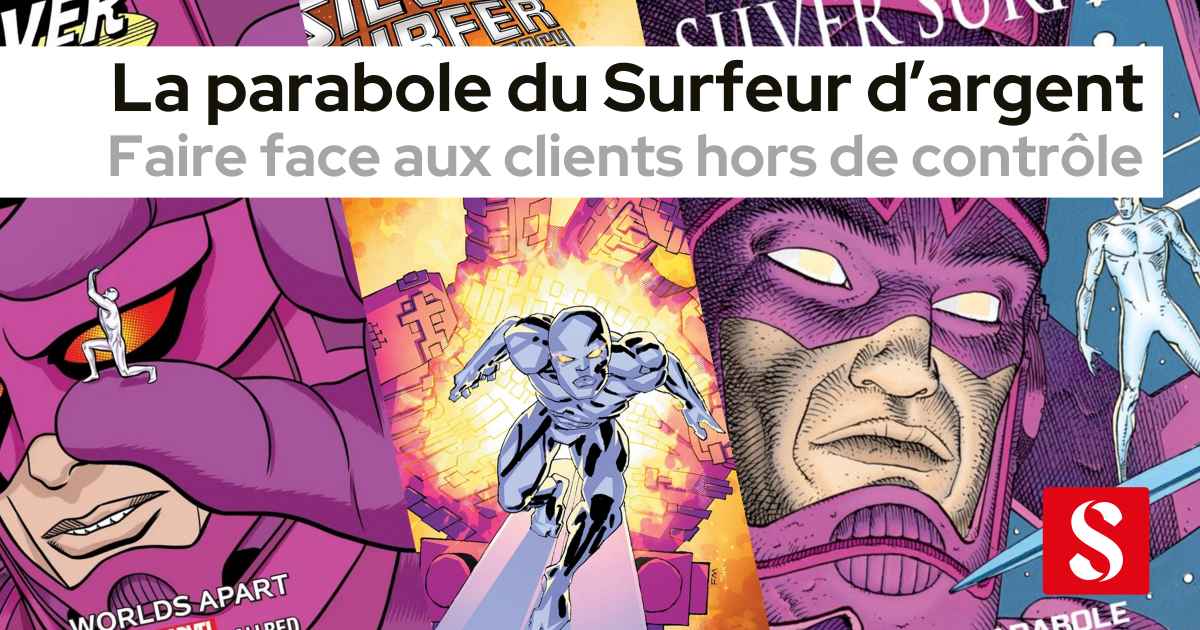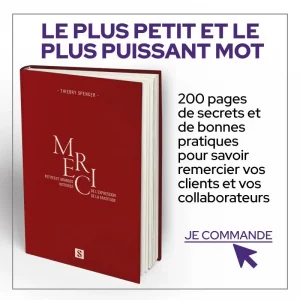Norrin Radd, alias le Surfeur d’Argent, est un personnage emblématique de l’univers Marvel, créé par Stan Lee et Jack Kirby en mars 1966 dans le numéro 48 de la bande dessinée « Fantastic Four ». Originaire de la planète Zenn-La, il était un astronome pacifiste jusqu’à ce que Galactus, le Dévoreur de Mondes, menace sa planète. Pour sauver son peuple, Norrin Radd accepte de devenir le héraut de Galactus, parcourant l’univers à la recherche de planètes à dévorer. Transformé par Galactus, il reçoit une peau argentée indestructible et une planche cosmique, lui conférant une vitesse supraluminique et d’immenses pouvoirs cosmiques. Il finit par se rebeller contre son maître et devenir hors de contrôle pour le géant de l’espace.
En 2008, j’avais fait du Surfeur d’Argent sur mon blog le symbole de la voix du client qui échappait au contrôle de la marque. A cette époque YouTube dénombrait 160 millions d’utilisateurs, Facebook en comptait 100 millions dans le monde (près de 7 en France), Twitter plus d’un million, Instagram n’existait pas, Tik Tok non plus… Aujourd’hui, Facebook en compte 3 milliards, YouTube 2,5 milliards et Tik Tok 1,6.
Depuis 17 ans, les clients sont-ils devenus hors de contrôle ? Le Surfeur d’argent a-t-il vaincu Galactus ?
La réponse est nuancée.
OUI On pourrait répondre oui dans le sens où les avis des clients postés sur les réseaux sociaux sont devenus la norme dans l’hôtellerie, la restauration, le tourisme et l’e-commerce en général. Leur influence est considérable et les entreprises y sont sensibles. TripAdvisor comptait 20 millions d’avis en 2008, c’est 850 millions aujourd’hui ! Tous les clients sont devenus des surfeurs d’argent potentiels, des producteurs de contenus qui échappent aux marques dans la plupart des cas.
NON De même, on pourrait répondre par la négative à cette question. Le client mécontent le plus célèbre du monde reste encore le chanteur Dave Caroll et sa guitare cassée par United Airlines. Mécontent du traitement qu’on lui réserve, il décide alors de composer une chanson en juillet 2009 qui totalise aujourd’hui 26 millions de vues ! (cf mon billet au sujet de Dave Carroll). L’exemple que je vais développer aujourd’hui nous montre que l’effet surfeur d’argent est bien vivace.
Place aux clients influenceurs
Le retentissement de cette affaire d’il y a seize ans pouvait laisser craindre une multiplication des mécontentements médiatisés, mais ce n’est pas vraiment le cas. Dave Carroll a laissé place aux influenceuses et aux influenceurs des médias sociaux, des internautes qui vendent leur voix si on peut dire. Selon Comarketing News, « les marques et les spécialistes du marketing du monde entier ont dépensé plus de 35 milliards de dollars en publicités d’influence en 2024, soit 9 % de plus que l’année précédente et bien que cela ne représente que 4% des dépenses totales du secteur de la publicité numérique, les publicités d’influence connaissent une croissance beaucoup plus rapide que tout autre segment de marché ».
Pour certaines entreprises, investir dans le marketing d’influence, c’est au pire s’assurer d’éteindre toute velléité de critique de la part d’une cliente ou d’un client, c’est au mieux acheter des avis positifs. C’est particulièrement vrai dans certains secteurs tels que la mode et la beauté, l’alimentation et le bien-être ou encore le tourisme et l’hôtellerie.
Le cas Bodyminute
C’est précisément dans le secteur de la beauté que se déroule actuellement en France un retentissant affrontement entre une influenceuse et une marque. L’influenceuse, c’est Laurène Levy (@Laulevy), spécialisée dans le bien-être au travail qui a publié en 2022 une vidéo humoristique racontant son expérience dans un Body Minute. Cette vidéo parodique, assez peu inspirée, a eu une audience limitée sur la plateforme chinoise Tik Tok. Mais le PDG de l’enseigne, Jean-Christophe David, a décidé de tenter de supprimer la vidéo, et dans cette action a finalement eu l’effet inverse, en attirant encore plus l’attention sur le contenu initial. Il juge quant à lui que « rigoler des petites gens n’a jamais honoré qui que ce soit » (source : le Parisien). On a d’un côté une influenceuse sur le bien-être au travail qui se moque de salariés et de l’autre le patron de l’entreprise qui les met dans la catégorie « petites gens ». Le match s’annonce de haut niveau.
On a ici une belle combinaison entre l’effet Surfeur d’argent (le client échappe au contrôle de la marque et lui résiste) et l’effet Streisand. L’effet Streisand désigne un phénomène où une tentative de suppression d’une information (généralement en raison d’une mauvaise réputation, d’un scandale ou d’un contenu jugé préjudiciable) entraîne paradoxalement une amplification massive de sa diffusion. Ce terme vient d’un cas impliquant la chanteuse Barbra Streisand, qui avait voulu empêcher la publication de photos de sa maison en 2003, mais cette action en justice avait provoqué une médiatisation bien plus grande que si elle n’avait rien fait.
Le PDG de Bodyminute a pris des mesures pour faire disparaître la vidéo et pour lutter contre cette influenceuse qui compte environ 500 000 abonnés toutes plateformes confondues. Courrier à son employeur, exploit d’huissier, plainte, assignation au tribunal de commerce de Paris, courriers aux collaborateurs de l’enseigne puis, plus récemment production d’une vidéo générée par l’intelligence artificielle avec un personnage fictif appelé « Cruella, reine de TikTok » qui interpelle l’autrice de la vidéo d’origine. Toutes ces actions ne font que produire du nouveau contenu d’internautes qui s’expriment à propos de l’enseigne, et pas toujours positivement.
Dans Le Parisien de janvier 2025, l’avocat Yann-Maël Larher rappelle qu’« entre liberté d’expression et droit des marques, le juge fait un examen de proportionnalité. Or la jurisprudence donne de plus en plus le pouvoir aux consommateurs ». Le Surfeur d’argent ne souffrirait donc pas de Galactus. Autre son de cloche au pays des super-héros de l’influence : un reportage du Mouv’ de Radio France dans lequel Caroline Roulin, avocate pénaliste déclare : « Les juges vont vérifier l’intention qui a motivé la publication du message ou de la vidéo. Tout l’enjeu, là, je pense, pour Lorraine, ça va être de déterminer si elle l’a fait de manière spontanée, comme une consommatrice qui était déçue d’un service ou à simple vocation parodique, mais sans arrière-pensée, ou est-ce qu’elle l’a fait dans un but lucratif ou commercial. Soit parce qu’elle répondait à une commande de son agence de communication, pour favoriser indirectement un concurrent de Body Minute, soit parce que dans le cadre d’une activité personnelle d’influenceuse, elle poursuit un but lucratif qui lui est propre et que les juges vont chercher à déterminer. Ce qui est sûr, c’est que cette simple vidéo ne peut pas être considérée comme du harcèlement, comme dénoncé par Jean-Christophe David. »
Comment savoir si vous êtes exposé au Surfeur d’argent, au client hors de contrôle ?
J’ai imaginé 8 critères pour déterminer si votre entreprise ou votre marque pourrait être exposée à un client hors de contrôle apte à ruiner votre réputation (comme en écho à mon billet intitulé Marques et médias sociaux : 7 critères stratégiques pour s’y investir).
- Secteur exposé. On pourrait dire avec un anglicisme la « talkabilité », c’est à dire la production naturelle de contenu de la part des clients, le potentiel de conversations dans votre profession. Si le secteur dans lequel vous agissez est sensible à la réputation en ligne, au partage de point de vue de la part de vos clients, si votre marque est un sujet de discussion, alors vous êtes dans une zone à forte probabilité de Surfeur d’argent. Les secteurs principaux que je listais précédemment sont : la mode, la beauté, l’alimentation, le bien-être ou encore le tourisme et l’hôtellerie. Bodyminute est dans un secteur exposé.
- Métier sensible. Plus une entreprise a une forte visibilité et des pratiques sujettes à controverse, plus elle est vulnérable au bad buzz. Une entreprise positionnée sur l’entrée de gamme (low cost) pour ses produits et ses services a plus de chance d’être scrutée quant à ses sources d’approvisionnement, son impact environnemental et ses conditions de travail que n’importe quelle autre entreprise. Bodyminute est très exposé. Il a suffi que cette polémique éclate pour que Mediapart consacre la semaine dernière un article à l’enseigne intitulé « Pressions, cadences, contrôle : chez Bodyminute, le travail à la chaîne des esthéticiennes ».
- Potentiel médiatique. C’est un critère subtil mais puissant, dans la mesure où il qualifie la capacité d’un avis client a dépasser le cadre d’un média social pour se répandre sur d’autres supports. Bodyminute est dans ce cas, comme a pu l’être United Airlines avec Dave Carroll aux Etats-Unis, ou encore Beckie Williams, une Anglaise qui dénonçait les tarifs des soutiens-gorges de Marks et Spencer en 2009 au Royaume-Uni (relire mon billet à ce sujet, écrit suite à une intervention en convention AMARC à l’époque). Il suffit que le sujet soit dans l’air du temps, que l’entreprise soit une multinationale, qu’elle ait une forte notoriété, que le patron ou la patronne soient médiatiques… Il y a de nombreux vents qui peuvent souffler sur une braise. Dans le cas de Bodyminute, le patron est le fils du coiffeur Jean-Louis David, une des raisons de cette médiatisation hors norme.
- Dépendance aux médias sociaux Une marque très présente sur les réseaux sociaux avec une forte communauté expose davantage ses actions aux critiques. Ajoutons qu’une entreprise qui mise principalement sur son image et le storytelling sans un fond solide prend un risque accru. Notons que Bodyminute n’est pas extrêmement dépendant (plus de 110 000 abonnés sur TikTok vs 1,5 millions pour KikoMilano par exemple).
- Faible gestion de la relation On pourrait aussi appeler ce critère l’aptitude à gérer la conversation. Je fais référence au fait d’avoir des moyens dédiés au sein de l’entreprise pour gérer les avis clients, les réclamations, les crises et plus généralement la relation client à distance. Le secteur de l’hôtellerie semble mieux armé que celui de la mode si on peut les comparer, 100% des clients sont connus, et ils sont tous invités à donner leur avis. Ce n’est pas encore le cas dans les enseignes de prêt-à-porter. Bodyminute, dans son secteur, n’est pas une entreprise connue pour sa gestion active de la relation (depuis que je fais la liste des entreprises récompensées dans le domaine de la relation client, soit environ 15 ans, je n’ai jamais recensé Bodyminute).
- Intensité de l’expérience client. Plus l’expérience est intime ou personnalisée, plus la réaction émotionnelle peut être forte. Un client qui se sent trahi peut avoir une réaction bien plus virulente qu’un simple mécontentement transactionnel. L’intensité de l’expérience dépend entre autres de la fréquence des contacts humains et du caractère immersif de l’expérience. Dans l’univers du bien-être et de la beauté, les clients viennent chercher plus qu’un service : une attention, une relation de confiance. Une mauvaise expérience peut donc vite virer à l’indignation. Bodyminute a une certaine intensité dans son expérience, ne serait-ce que par le fait que son service est matérialisé d’une part et qu’il se produit dans des conditions d’intimité d’autre part.
- Effet communautaire et militantisme. On pourrait dire qu’un client mécontent seul n’est pas un danger. Mais si son histoire trouve un écho auprès d’une communauté engagée, cela peut devenir viral. Certains secteurs sont plus sensibles à l’adhésion de groupes activistes (écologie, bien-être animal, etc.). Cependant, ce critère peut jouer dans les deux sens : effet multiplicateur d’une communauté engagée et solidaire qui relaye le témoignage d’un membre, ou bien effet de minoration du fait d’un groupe de clients motivés qui ne reconnaissent pas le client critique parmi les membres de la communauté. Dans le cas de Bodyminute, cet effet ne semble pas avoir joué dans un sens comme dans l’autre.
- Effet de surprise ou de trahison. Un écart entre l’image projetée, la promesse et la réalité vécue amplifie la déception et favorise l’emballement médiatique. Les marques qui se positionnent sur des valeurs fortes (éthique, inclusivité, bien-être, respect, etc.) prennent plus de risques si leurs pratiques ne sont pas alignées. Bodyminute affirme sur son site être « N°1 des instituts de beauté en France. » puis clame : « Offrez-vous le luxe du Bien-Être ! ». A vous de juger !
L’effet Surfeur d’Argent illustre bien la réalité des marques dans un monde ultra-connecté : le contrôle total de l’image et du discours appartient désormais autant, sinon plus, aux clients qu’aux entreprises elles-mêmes. À travers l’affaire Bodyminute, on voit comment une réaction mal maîtrisée face à une critique peut amplifier un bad buzz au lieu de l’éteindre.
Si toutes les marques ne sont pas exposées au même degré, les critères listés dans ce billet montrent que certaines entreprises sont plus vulnérables que d’autres à ces crises d’opinion. Une chose est certaine : ignorer le pouvoir des clients et des influenceurs, ou mal y répondre, peut transformer un simple mécontentement en crise de réputation majeure.
En fin de compte, le Surfeur d’Argent ne peut pas être arrêté. Mais les marques peuvent vivre en harmonie avec lui, en cultivant une relation client authentique, en investissant dans la gestion des avis et en restant alignées avec leurs valeurs. C’est là tout l’enjeu de la relation client à l’ère des médias sociaux : anticiper plutôt que subir, dialoguer plutôt que censurer.
1152ème billet signé Thierry Spencer, conférencier, créateur du blog Sens du client, consultant et co-fondateur de KPAM Next, auteur du récent livre « Merci, petites et grandes histoires de l’expression de la gratitude » .
Mon livre blanc des tendances client 2025 qui vient de sortir est en téléchargement gratuit en suivant ce lien.