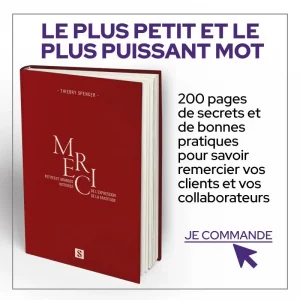Comme le souligne l’excellent News magazine Le Point dans son édition du 5 janvier 2006 dans un billet confidentiel intitulé «le juste mot», nos trois personnalités ci-dessus ont exploité la richesse de la langue de Molière.
En effet, selon Le Point, Anne-Marie IDRAC (à droite sur la photo), Présidente de la RATP a employé le mot « voyageurs » lors d’une réunion sur le thème des transports publics, alors que Dominique Perben, Ministre des transports (au centre de la photo) usait du terme « usagers » et enfin Louis Gallois, Président de la SNCF (à gauche sur la photo) a préféré parler de « clients ».
Il est vrai que chez Colgate Palmolive, à qui j’ai envoyé un tube cassé de lessive Génie samedi dernier (voir leur réponse très bientôt sur ce blog), on parle de consommateurs.
Le consommateur désigne l’informe petite unité dans une grande stratégie de mass-marketing (il est vrai que Colgate vend à des distributeurs qui sont ses clients). On parle ici de la ménagère de moins de 50 ans par exemple, dont je suis une des représentations, tel un avatar de la religion hindoue.
Le voyageur, pour reprendre Madame Idrac est celui qui est véhiculé, et dont l’expérience se limite au passage d’un point géographique à un autre, un peu comme un voyageur astral libéré de son corps matériel.
L’usager, dans la bouche du Ministre, est celui qui paye ses impôts, lesquels servent à construire et entretenir des équipements publics dont il a l’usage. Un peu comme un castor qui paye de sa denture les bûches qui feront sa maison. Vous noterez ici que les castors ne sont pas doués de la faculté de parler.
Le client, en revanche, est un être qui fait l’expérience de plusieurs vies (7 au total).
Tout d’abord, il prend connaissance des offres de transport qui s’offrent à lui, influencé par des milliers de stimuli (pour en citer quelques uns : son corps au pied droit, une affiche de 4 mètres par 3, une campagne de marketing viral, le plaisir de l’auto stop, le bonheur du vélo, la nécessité d’amortir sa voiture…) .
Dans la deuxième vie, il choisit en son âme et conscience, aidé de ses pieds et de son porte-monnaie, un moyen de transport.
Ensuite, il décide d’en faire l’expérience en commençant par la transaction financière au guichet, sur internet ou par téléphone.
Dans l’étape d’après, il doit composter (passage obligé) et se réjouir de l’accusé de validation sonore : « Shklong », « Vlak » ou bien « Ding Dong » (avec le passe Navigo).
Il prend place dans le véhicule (lorsqu’il a réservé ou bien en cas de faible affluence). A ce moment, il est transporté et profite pleinement de la prestation.
En arrivant à destination, il tire un bilan de son expérience et compare mentalement la promesse initiale à la réalité.
Dans la dernière étape, que nous appellerons ici la septième incarnation, il va faire un choix pour le futur (pas trop lointain) et donc arbitrer pour ses prochains déplacements. Il pourra témoigner de son expérience à son entourage, à un enquêteur lors d’une étude, au service clients ou sur son blog. Le client atteint la sérénité au terme de ses incarnations.
Pour atteindre cette sagesse « nirvanesque », ma recommandation est de ne pas trop faire de poésie, de ne pas trop utiliser des termes proches ou désuets pour qualifier le «client», même si l’on se fâche avec les défenseurs du service public et les amoureux de la langue française. La raison en est simple : lorsqu’on dirige des milliers de personnes comme Président ou Directeur général, il vaut mieux parler avec les mots qui correspondent à la réalité (un voyageur est un client, et un usager est un client). De cette façon, on inculque plus facilement à ses employés le sens du client ! J’ajoute un élément qui vous donnera une idée du chemin à parcourir : dans les 7 petites lignes de l’article du magazine Le Point, le journaliste qualifie le terme employé par Louis Gallois, c’est à dire « client », de « vocable très commercial ». C’est le seul point de vue exprimé dans ce billet ; dommage pour les clients -oops pardon-, je voulais dire les lecteurs du Point.